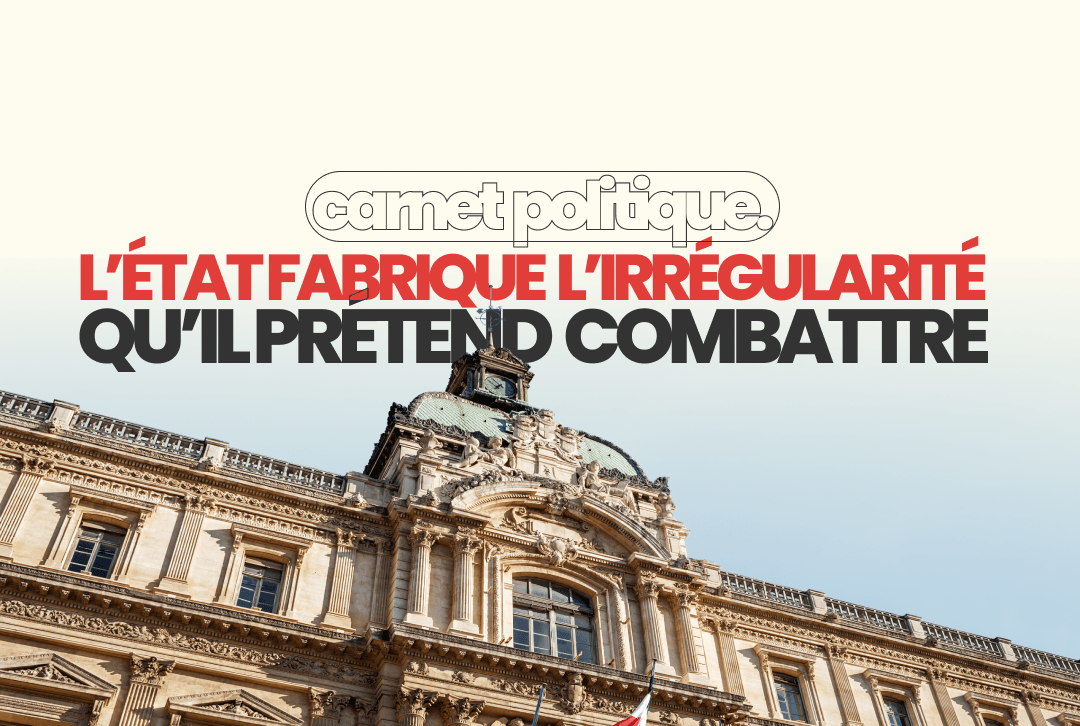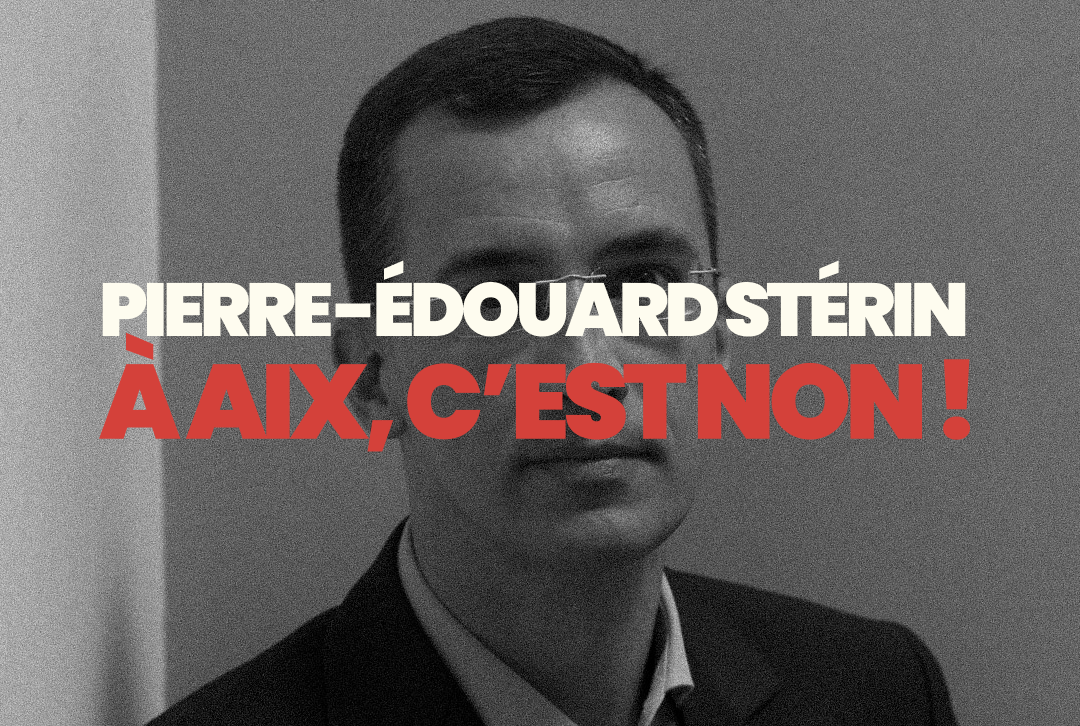Il est des débats qui exigent davantage que des convictions. Ils exigent une conscience.
L’Assemblée nationale examine en deuxième lecture la proposition de loi relative à l’aide à mourir.
La fin de vie ne peut être abordée comme une simple extension des libertés individuelles. Elle touche à la vulnérabilité, à la dépendance, à la solitude, à la dignité.
À gauche, nous avons toujours porté l’émancipation. Nous avons élargi les droits, reconnu des libertés nouvelles, combattu des interdits injustes. Le débat actuel s’inscrit dans cette histoire. Je l’entends. Je la respecte.
Mais une liberté n’est réelle que si les conditions de son exercice sont garanties.
Or, aujourd’hui, l’égalité face aux soins palliatifs n’est pas une réalité pleine et entière.
En 2023, la Cour des comptes constatait dans son rapport que seulement 48 % des besoins en soins palliatifs étaient effectivement couverts en France. Autrement dit, plus d’un patient sur deux relevant de ces soins n’y a pas pleinement accès. Plusieurs départements ne disposent toujours pas d’unités complètes.
Dans les Bouches-du-Rhône, malgré les progrès engagés, les tensions demeurent fortes : manque de personnels spécialisés, délais d’admission, disparités entre Marseille, Aix, les zones périurbaines ou rurales. La stratégie nationale prévoit 1,1 milliard d’euros sur dix ans pour généraliser les unités de soins palliatifs dans chaque département. C’est un effort important. Mais il reste à déployer concrètement.
Le débat parlementaire l’a montré : même l’idée de rendre l’accès aux soins palliatifs juridiquement opposable a été écartée, au motif qu’un droit proclamé sans moyens suffisants risquerait de créer davantage de contentieux que d’offre réelle.
En tant que député, j’ai voulu voir par moi-même.
J’ai rencontré les équipes du Centre hospitalier intercommunal d’Aix-Pertuis.
J’ai échangé avec des professionnels confrontés chaque jour à la douleur, à l’accompagnement des familles, aux situations de grande détresse.
J’ai rencontré les bénévoles de L’Arche.
Je reçois régulièrement des citoyens, des soignants, des proches aidants qui m’alertent sur les difficultés concrètes.
Partout, j’ai vu la même chose : un engagement admirable, une humanité profonde, mais aussi des équipes sous tension, des moyens contraints, des familles parfois épuisées.
La question n’est donc pas théorique. Elle est politique.
Peut-on ouvrir un droit aussi irréversible alors même que l’égalité d’accès au soin et à l’accompagnement n’est pas pleinement garantie ?
Je crains qu’en l’état, dans une société traversée par les inégalités sociales, la solitude et la fragilité des services publics, la liberté de choisir sa mort puisse, pour certains, devenir une liberté contrainte. La peur d’être un poids. La crainte de coûter trop cher. L’isolement.
La gauche n’a jamais défendu une liberté abstraite. Elle a toujours voulu corriger les inégalités réelles.
Cela ne signifie pas ignorer la souffrance. Je mesure les situations extrêmes. Je respecte celles et ceux qui soutiennent ce texte avec sincérité. Je refuse les caricatures.
Mais ma conviction demeure : avant d’instituer un droit à mourir, assurons-nous que chaque citoyen dispose réellement du droit d’être soigné, entouré, accompagné dignement.
Investissons massivement dans les soins palliatifs.
Renforçons l’hôpital public.
Formons davantage de soignants spécialisés.
Garantissons une présence humaine jusqu’au dernier instant.
Après une réflexion longue et exigeante, j’ai fait le choix de ne pas voter ce texte en première lecture. Je maintiendrai cette position le 24 février. Ce n’est pas un désaveu de mon groupe. C’est une décision de conscience, au nom de l’égalité réelle et de la protection des plus fragiles.
La dignité ne se décrète pas dans un article de loi.
Elle se construit dans le soin, dans la solidarité, dans la présence.
Je choisis la voie du soin. Avec respect pour toutes les sensibilités.
Et avec fidélité à l’idéal républicain qui nous oblige.